Le Président américain Donald Trump a ravivé la tension diplomatique avec Abuja, le 2 novembre 2025, en déclarant que les États-Unis « n’excluaient pas une intervention militaire au Nigeria » pour « protéger les Chrétiens persécutés ». Une sortie inhabituelle, mais loin d’être isolée puisqu'elle s’inscrit dans une logique politique et religieuse qui dépasse largement le cadre sécuritaire.
Ce n’est pas la première fois que Trump invoque la défense des Chrétiens pour justifier une posture offensive vis-à-vis d’un pays africain. En 2019 déjà, alors qu’il était en campagne pour un second mandat, il avait accusé publiquement le gouvernement nigérian de « fermer les yeux » sur les attaques contre les communautés chrétiennes du nord. En mai 2025, lors de la réception du Président sud-africain Cyril Ramaphosa à la Maison-Blanche, il avait dénoncé un prétendu « génocide contre les fermiers blancs ». Cette rhétorique, déjà utilisée en 2018, a depuis été réactivée, dans un contexte électoral américain marqué par la montée des Évangélistes et des nationalistes religieux. La promesse de « sauver les Chrétiens du Nigeria » parle directement à ce socle électoral, essentiel pour les prochaines élections de mi-mandat.
Mais, derrière la façade humanitaire, plusieurs analystes y voient une manœuvre géopolitique. Le Nigeria, première économie d’Afrique et producteur majeur de pétrole, représente un enjeu stratégique autant qu’un symbole religieux. Washington, fragilisé par son retrait du Sahel, tente de regagner de l’influence dans une région où la Russie, la Chine et la Turquie consolident leurs positions. Les États-Unis importent encore une part significative du pétrole nigérian, bien que réduite depuis 2015, ce qui maintient le pays au cœur de leurs calculs énergétiques. La référence religieuse sert ainsi à légitimer un possible retour de puissance plus idéologique que militaire.
Les autorités nigérianes n’ont pas réagi publiquement aux propos du Président américain, mais au sein de la CEDEAO le ton est à la prudence. Plusieurs diplomates rappellent que toute intervention étrangère non sollicitée violerait la souveraineté régionale et risquerait d’alimenter la défiance, déjà croissante, envers les puissances occidentales. Dans les capitales du Sahel, les déclarations de Trump ont été accueillies avec scepticisme et perçues comme un signal d’un retour à une diplomatie d’ingérence morale.
Si cette menace ne débouche pas sur une action concrète, elle révèle une constante, à savoir l’usage du religieux et de la morale comme instrument de politique étrangère. En rejouant la carte de la croisade pour les Chrétiens, Donald Trump ravive une lecture quasi religieuse de l’Afrique, entre ferveur prosélyte, intérêts pétroliers et ambitions électorales.
































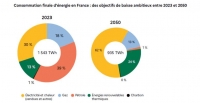








































































































































































































































































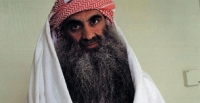






















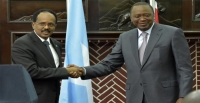




















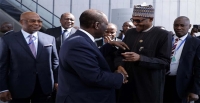










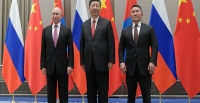
































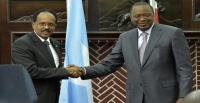























































































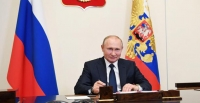















































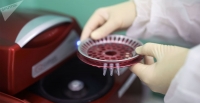




































































































































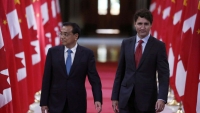
















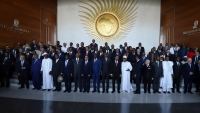





























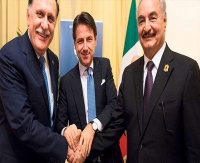







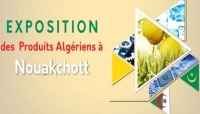




































































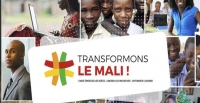










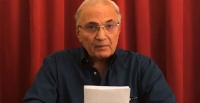


































































































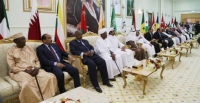


































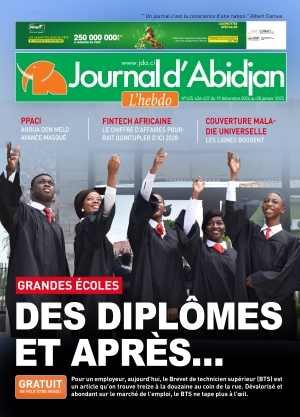

 JDF TV
L'actualité en vidéo
JDF TV
L'actualité en vidéo











