George W. Bush a fait campagne contre les guerres étrangères et les tentatives de reconstruction nationale dans des pays lointains lorsqu'il s'est présenté à l'élection présidentielle américaine en 2000. Pourtant, une fois à la Maison Blanche, il a envoyé des dizaines de milliers de soldats en Afghanistan et a tenté d'y instaurer la démocratie, puis a fait de même en Irak.
Donald Trump a également dénoncé l'ingérence dans ce qu'il a qualifié de « pays de merde », mais il a maintenant envoyé des forces spéciales américaines au Venezuela pour capturer son dictateur, Nicolás Maduro. Mais au lieu d'essayer de rétablir la démocratie au Venezuela, Trump s'est maintenant associé à ce qu'il qualifie lui-même de « régime corrompu, criminel et illégitime ».C'est comme si le maire de Chicago en 1930 avait d'abord qualifié Al Capone de gangster, puis s'était associé avec le successeur de Capone, Frank Nitti.
Il y a deux explications à l'attitude de Trump. La première est qu'il ne se soucie que des affaires. Tant qu'il peut faire couler à nouveau du pétrole et enrichir quelques amis au passage, il est heureux.
Ce n'est pas une théorie farfelue, étant donné que Trump a prononcé le mot « pétrole » 20 fois lors de la conférence de presse qui a suivi l'enlèvement de Maduro, et pas une seule fois le mot « démocratie ». Mais tant qu'un régime corrompu, criminel et illégitime dirigera le Venezuela, les compagnies pétrolières n'investiront pas les dizaines de milliards de dollars nécessaires pour reconstruire l'industrie pétrolière du pays. Comme le PDG d'ExxonMobil l'a dit en face à Trump, le Venezuela est aujourd'hui «ininvestissable ».
Les âmes plus bienveillantes, réticentes à croire que le leader du monde libre ne se soucie que de l'argent et qu'en tant que magnat des affaires, il puisse être si mauvais pour prédire ce que feront les investisseurs, ont une autre explication : appelons-la la théorie de l'Irakistan.
Elle se résume ainsi : en Irak et en Afghanistan (ainsi qu'en Somalie, en Libye, en Haïti et en République démocratique du Congo), les puissances occidentales se sont essayées à la reconstruction nationale et ont échoué. Elles ont échoué parce que les pays en question étaient divisés par des clivages sectaires, manquaient de dirigeants démocratiques crédibles, n'avaient aucune tradition de contrôle et d'équilibre des pouvoirs et d'État de droit, et ne pouvaient compter sur une classe moyenne suffisamment importante pour servir de point d'ancrage politique.
Comme le Venezuela souffrirait des mêmes défauts (notamment la présence de gangs armés et une opposition divisée), les États-Unis agissent avec sagesse en s'abstenant de tenir des propos extravagants sur la transition démocratique. La seule façon de garantir la stabilité est de conclure un accord avec les voyous au pouvoir.
La question de savoir si la reconstruction d'une nation est toujours vouée à l'échec (pensons à l'Allemagne et au Japon après la guerre) sera abordée un autre jour. Mais une chose est claire : élaborer une politique à l'égard du Venezuela par analogie avec l'Irak et l'Afghanistan est tout aussi insensé que de croire que Caracas et le bassin de Maracaibo sont sur le point d'être inondés par des milliards de dollars d'investissements privés. La théorie de l'e irakien semble prudente, mais l'appliquer au Venezuela relève tout simplement de l'ignorance.
Passons en revue la liste, en commençant par le constat que le Venezuela ne connaît aucune des divisions sectaires et linguistiques qui ont miné la stabilité politique en Irak et en Afghanistan. Au contraire, le Venezuela se situe à l'autre extrémité du spectre : c'est un pays où presque tout le monde parle la même langue et pratique la même religion. Bien sûr, le pays souffre de grandes disparités de revenus et d'inégalités raciales douloureuses. Mais c'est aussi le cas des États-Unis.
L'argument selon lequel l'opposition à la dictature vénézuélienne est divisée n'est pas nouveau. Les opposants à Hugo Chávez, puis à Maduro, ont effectivement eu du mal à s'unir. Mais ils y sont parvenus, en présentant un candidat qui a obtenu les deux tiers des voix lors de l'élection présidentielle de juillet 2024. Le seul problème est que Maduro a volé l'élection, ce que les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Union européenne et pratiquement toutes les démocraties du monde n'ont pas manqué de dénoncer.
Cela nous amène à la question d'un leadership démocratique crédible. Le Venezuela a un président démocratiquement élu : Edmundo González, qui a sans aucun doute remporté les élections de 2024. Et c'est autour de González que l'opposition s'est unie, uniquement parce que Maduro a illégalement interdit à María Corina Machado, beaucoup plus populaire et charismatique, de se présenter.
Machado, qui a remporté le prix Nobel de la paix pour ses efforts visant à rétablir la démocratie au Venezuela (et dont la décision politique calculée de remettre sa médaille Nobel à Trump n'a pas encore porté ses fruits), est la dirigeante d'un mouvement politique crédible et démocratique qui pourrait très bien gouverner le Venezuela. On ne peut pas en dire autant de l'Irak ou de l'Afghanistan. Contrairement à l'Irak ou à l'Afghanistan (et encore moins à Haïti, à la Libye ou à la RDC), le Venezuela a longtemps été une démocratie libérale fonctionnelle – imparfaite, comme tant d'autres, mais suffisamment démocratique pour avoir des élections libres, des transferts de pouvoir pacifiques, des partis politiques institutionnalisés, la liberté de la presse, un système judiciaire fonctionnel et à peu près tout le reste. Le Venezuela a une tradition démocratique suffisamment forte pour que même Chávez se soit senti obligé d'organiser des élections (et, pendant un certain temps, de ne pas les truquer).
En ce qui concerne une classe moyenne forte, des professionnels et des technocrates compétents, et d'autres acteurs capables de promouvoir la stabilité politique, le Venezuela coche également ces cases. L'économie a reculé de 80 % depuis l'arrivée au pouvoir de Maduro (oui, vous avez bien lu), et huit millions de Vénézuéliens ont été contraints de quitter leur pays, de sorte que la classe moyenne n'est plus ce qu'elle était autrefois, la plus riche d'Amérique latine. Mais le pays regorge de professionnels compétents et compte une diaspora qui pourrait ramener les dernières connaissances techniques une fois le régime disparu. La démocratie s'est implantée en Argentine, au Chili et en Uruguay en grande partie grâce à la contribution des exilés de retour après la chute des dictatures. La même chose pourrait se produire au Venezuela.
Méfiez-vous donc des fausses analogies historiques. La stabilité ne nécessite pas le maintien de la dictature au Venezuela. C'est plutôt l'inverse : avec le départ de Maduro, seule la démocratie peut apporter une paix durable et une chance de restaurer la prospérité du pays.
By Andrés Velasco



























































































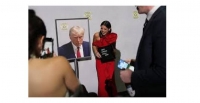






























































































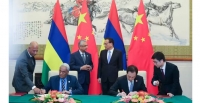








































































































































































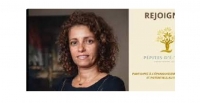




























































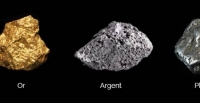

















































































































































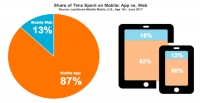





















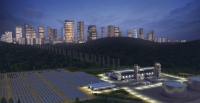































































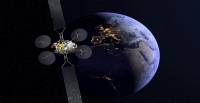













































































































































































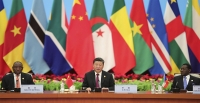

















































































































































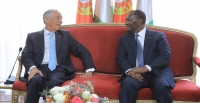







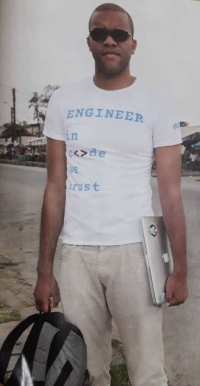








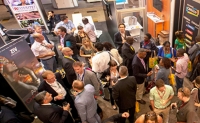






































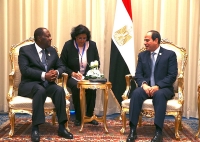
























































































































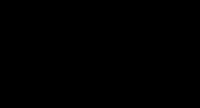

































































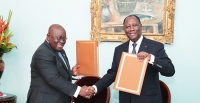














































































































































































































































































































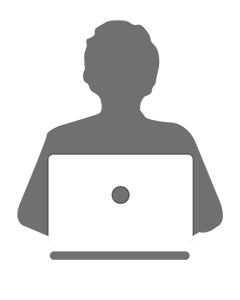
 JDF TV
L'actualité en vidéo
JDF TV
L'actualité en vidéo











