WASHINGTON, DC Il ne se passe pas un jour sans que de nouveaux titres de presse nannoncent que lIA est sur le point de transformer léconomie. Bien que les affirmations selon lesquelles « lIA est la nouvelle électricité » soient exagérées, nous devons nous préparer à des changements profonds. Lun des mécanismes les plus puissants et les plus fiables pour faire en sorte que lIA bénéficie à lensemble de la société est également lun des plus courants : la fiscalité.
À quoi ressemblerait concrètement une taxe sur l’IA ? L’approche la plus pratique consisterait à cibler les principaux intrants et les paramètres les plus tangibles du développement de l’IA : l’énergie, les puces électroniques ou le temps de calcul. Les États-Unis imposent d’ores et déjà une taxe de 15 % sur les ventes de puces d’IA spécifiques à la Chine, et bien qu’il s’agisse techniquement d’un contrôle des exportations, cela démontre comment pourrait fonctionner une taxe sur les intrants de l’IA. D’autres suggèrent de repenser la taxation du capital, afin de tenir compte des changements économiques induits par l’IA. Il s’agirait d’une taxe sur l’IA dans son principe, mais plus large dans son application.
La structure de toute taxe sur l’IA dépendrait des objectifs que les gouvernements souhaitent atteindre. Une chose est néanmoins certaine : le débat actuel est bien plus fondé et urgent qu’il ne l’était lorsque Bill Gates a évoqué l’idée d’une « taxe sur les robots » en 2017, reprise plus tard par Bernie Sanders et d’autres.
Certains s’interrogeront bien entendu sur les raisons pour lesquelles nous devrions taxer l’IA. La réponse à cette question illustre deux fondamentaux liés aux systèmes fiscaux ainsi qu’à la manière dont l’IA transforme l’économie. Premièrement, de nombreux pays taxent aujourd’hui les travailleurs humains plus lourdement que leurs potentiels concurrents d’IA sur le marché du travail. Dans le cas des États-Unis, environ 85 % des recettes fédérales proviennent de l’imposition des citoyens et de leur travail (via l’impôt sur le revenu et les cotisations sur les salaires), alors que le capital et les bénéfices des entreprises sont beaucoup moins taxés. Les technologies telles que l’IA bénéficient d’un traitement de faveur sous la forme de déductions généreuses, de faibles taux d’imposition des sociétés, ainsi que d’exemptions.
Deuxièmement, les économistes s’attendent à ce que l’IA entraîne une augmentation du rendement financier du capital par rapport à celui du travail, même si elle ne provoque pas de chômage. La version la plus extrême de ce phénomène impliquerait des agents d’IA capables de se concevoir, de se reproduire et de se gérer eux-mêmes, ce qui signifierait que le capital effectuerait son propre travail. Dans le cadre des politiques fiscales actuelles, une telle évolution creuserait les inégalités, et réduirait la part des recettes publiques dans le PIB.
Une taxe sur l’IA pourrait contribuer à davantage d’équilibre entre les êtres humains et les machines. En début d’année, le PDG d’Anthropic, Dario Amodei, a mis en garde sur la possibilité que l’IA entraîne la disparition de la moitié des emplois de bureau de niveau débutant, et qu’elle fasse grimper le chômage jusqu’à un taux de 10 à 20 % d’ici cinq ans. La matérialisation de ces prévisions dépendra probablement en partie des politiques appliquées. Une taxation du travail plus lourde que celle du capital fait pencher la balance du côté de l’automatisation, laquelle remplace les travailleurs humains plutôt que de les compléter. La moindre des choses, c’est que nous ne laissions pas notre système fiscal contribuer à mettre des personnes au chômage.
Par ailleurs, les perspectives budgétaires s’assombrissant actuellement, une taxe sur l’IA pourrait protéger les recettes publiques contre les chocs induits par la technologie. Si des pertes d’emplois massives ou d’importants ralentissements des embauches survenaient effectivement, les gouvernements qui recourent à l’impôt sur le revenu et aux charges sociales pourraient se retrouver confrontés à des crises budgétaires, même si de nouveaux emplois adaptés à l’IA émergeaient par la suite.
Dans un registre plus optimiste, des politiques fiscales judicieuses – associée à un boom de la productivité favorisé par l’IA – pourraient contribuer à la résolution de problèmes budgétaires structurels. Les pays riches peinent déjà à financer les soins de santé et les retraites de leur population vieillissante, tandis que les pays pauvres sont confrontés à un défi inverse : éduquer et employer des populations jeunes et nombreuses en dépit d’assiettes fiscales réduites. Les revenus générés par l’IA pourraient faire partie de la solution à ces problèmes opposés.
Alternativement, les recettes pourraient être orientées vers d’autres causes liées à l’IA. Les prélèvements dédiés, qui renvoient des recettes vers le secteur dont elles proviennent – tels que la taxe sur le carburant aux États-Unis, qui finance les autoroutes, ou la redevance télévisuelle au Royaume-Uni, qui soutient la BBC – soulignent que l’objectif consiste à améliorer les bienfaits publics de la technologie taxée. Nous pourrions en faire de même dans le cas de l’IA : financer la modernisation des réseaux, les technologies d’éducation, la formation des travailleurs, les modèles d’IA en libre accès, la recherche sur la sécurité en matière d’IA, ou encore la préservation de la santé mentale.
Une taxe sur l’IA pourrait également soutenir l’assurance chômage et la reconversion des travailleurs déplacés, voire nous permettre de progresser en direction d’objectifs politiques plus larges concernant l’IA. Elle pourrait par exemple dissuader la surconsommation d’énergie, les émissions de gaz à effet de serre, le manque de qualité des contenus d’IA, les comportements anticoncurrentiels, ou encourager la production de nouvelles énergies et l’adoption de modèles plus sûrs.
La taxation de l’IA peut sembler politiquement irréaliste. Les dirigeants politiques ne souhaitent pas freiner l’innovation, ni perdre du terrain dans la course mondiale à l’IA. Cette réticence pourrait toutefois s’atténuer à mesure que les citoyens prendront conscience des problèmes. Si la « victoire » en matière d’IA signifie des êtres humains en meilleure santé, des enfants plus heureux, une main-d’œuvre plus compétente, et des sciences plus solides – pas seulement des modèles plus gigantesques ou des géants technologiques plus riches encore – alors une taxe sur l’IA peut y contribuer.
Il est par ailleurs peu probable qu’une telle taxe freine l’innovation. L’IA n’est pas un jeune secteur fragile, mais une technologie qui existe depuis 70 ans, désormais soutenue par les plus grandes entreprises de la planète, dont les investissements ont dépassé les 250 milliards $ rien qu’en 2024. Une taxe sur l’IA pourrait être structurée de manière à n’entraver ni la sécurité nationale, ni la concurrence sur le marché, ni la recherche.
Quoi qu’il en soit, les crises peuvent rapidement faire évoluer les mentalités. Si l’IA devient la grande coupable d’un chômage de masse ou de chocs budgétaires, les dirigeants élus et les responsables de l’ensemble du spectre politique entendront agir. Mieux vaut préparer des options judicieuses dès aujourd’hui que de devoir improviser plus tard.
Comme l’a écrit en 2021 le PDG d’OpenAI, Sam Altman, « Le monde changera si rapidement et si profondément qu’une refonte politique tout aussi radicale sera nécessaire pour répartir cette richesse, et permettre à davantage d’individus de mener la vie qu’ils souhaitent ». Altman spéculait à cette période sur le développement d’une intelligence artificielle générale encore plus avancée, mais ses propos sont d’ores et déjà valides : les mesures politiques doivent suivre le rythme de la technologie, et anticiper le changement.
D’une manière ou d’une autre, l’IA refaçonnera nos économies et nos sociétés. Pour autant, l’issue n’est pas écrite à l’avance. À la question de savoir si nous connaîtrons un avenir dans lequel les individus et les communautés s’épanouiront, la réponse dépendra des politiques que nous appliquerons. Taxer l’IA ne signifie pas punir l’innovation, mais veiller à ce que ses bienfaits soient partagés, et les risques gérés dans l’intérêt général. Plus tôt nous débuterons ce travail, mieux nous serons préparés à utiliser l’IA pour créer l’avenir que nous souhaitons.
Les opinions exprimées dans cet article n’engagent que son auteur, et aucunement l’institution qu’il représente.
Par Kevin O’Neil












































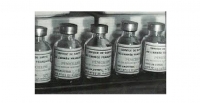






















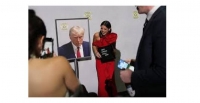


























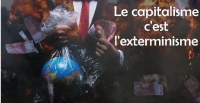
















































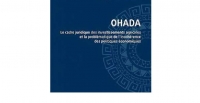

















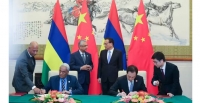















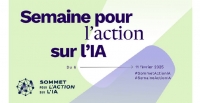













































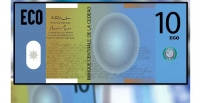
























































































































































































































































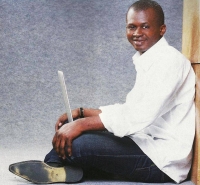



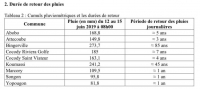




























































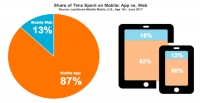


















































































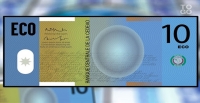


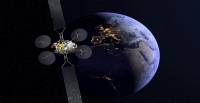






































































































































































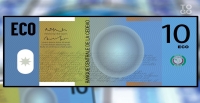






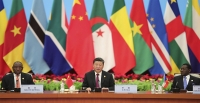

















































































































































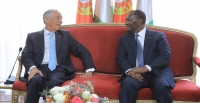







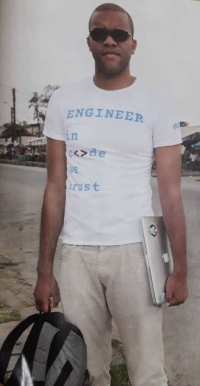








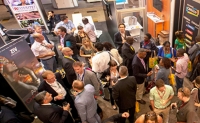






































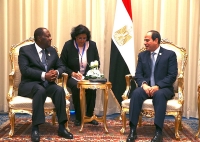









































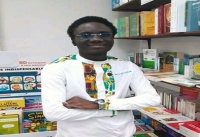














































































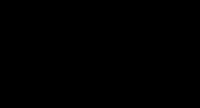

































































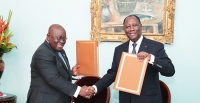








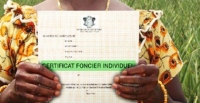




































































































































































































































































































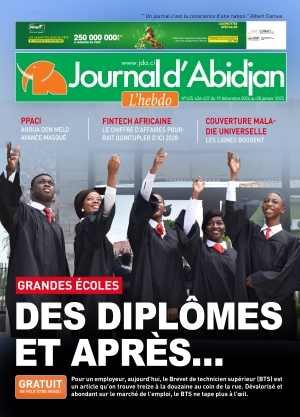

 JDF TV
L'actualité en vidéo
JDF TV
L'actualité en vidéo











