CAPE TOWN La Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques (COP30) qui vient de sachever à Belém, au Brésil, est intervenue au cours dune année décisive pour les négociations mondiales sur le climat. Les États étaient tenus de présenter leurs contributions déterminées au niveau national (CDN), conformément à laccord de Paris 2015 sur le climat. Dans le même temps, de nombreux pays y compris de grandes puissances telles que les États-Unis ont reculé quant à leurs engagements climatiques, dans un contexte de fragmentation et dincertitude géopolitiques croissantes.
Les perspectives ne sont guère prometteuses. Dans son dernier rapport sur les écarts d’émissions, le Programme des Nations Unies pour l’environnement nous met en garde : si les États s’en tiennent strictement à leurs CDN actuelles, et même s’ils les respectent pleinement d’ici 2035, le monde se réchauffera de 2,3 à 2,5°C d’ici 2100 – bien au-dessus de l’objectif de 1,5°C fixé par l’accord de Paris. Cette trajectoire entraînerait de graves conséquences à l’échelle planétaire, et des effets particulièrement dévastateurs en Afrique, où les besoins d’adaptation font l’objet d’un sous-financement chronique.
Les enjeux sont en effet encore plus élevés pour l’Afrique, dans la mesure où la résilience climatique et le développement sont étroitement liés sur le continent. Il est impossible pour les pays africains de bâtir la résilience sans faire progresser la croissance, et inversement. Or, la communauté internationale a démontré à maintes reprises que l’on ne pouvait pas compter sur elle pour financer l’un comme l’autre de ces objectifs. Au contraire, les pays riches réduisent aujourd’hui leurs budgets d’aide à l’étranger, alors même qu’ils se disputent de plus en plus les minerais et autres actifs stratégiques de l’Afrique.
L’actuelle fragmentation politique a toutefois ceci de positif que les règles et systèmes qui entravent les politiques industrielles et de développement de l’Afrique sont en train de s’éroder. Comme le souligne un récent document de synthèse du Groupe d’experts sur le développement industriel vert, les dirigeants africains doivent profiter de cette opportunité pour adopter une approche « possibiliste ».
L’espace politique créé par le délitement de l’ordre multilatéral doit être exploité. L’Afrique ne peut se permettre le luxe de choisir entre la décroissance (qui risque de perpétuer la pauvreté) ou le modèle consistant à « polluer maintenant, écologiser plus tard » (qui pourrait enfermer le continent dans le recours aux combustibles fossiles). L’Afrique doit au contraire développer sa propre approche d’industrialisation verte, ce qui implique pour le continent de se diversifier au-delà des exportations de matières premières, de l’agriculture de subsistance, des services à faible productivité, et de promouvoir des industries à plus forte valeur ajoutée, compatibles avec le climat, qui stimulent le développement et renforcent la résilience.
L’Afrique possède tous les atouts nécessaires à une transition industrielle verte réussie : d’abondantes ressources en énergies renouvelables, une population de jeunes en pleine croissance – qui devrait représenter d’ici 2050 environ 25 % des habitants de la planète en âge de travailler – d’importants gisements de minerais essentiels aux technologies numériques et d’énergie propre, ainsi qu’un immense potentiel agricole.
Le développement d’industries faiblement émettrices de carbone – textile, alimentation, boissons, et autres biens de consommation – ainsi que leur approvisionnement en énergies renouvelables peuvent produire des bienfaits immédiats. Les parcs industriels verts et les zones économiques spéciales peuvent catalyser ces transitions, tandis que des initiatives plus larges d’économie circulaire peuvent contribuer à la conservation de la valeur ainsi qu’à l’amélioration de la durabilité.
Les pays africains peuvent également transformer l’agriculture en augmentant la productivité, en investissant dans des technologies d’adaptation des cultures au climat, ainsi qu’en exploitant les possibilités d’exportation offertes par l’industrialisation des produits frais. Par ailleurs, la baisse des prix des intrants, notamment au moyen d’une politique de la concurrence visant à briser les monopoles sur les engrais, permettrait de bâtir la résilience et de réduire la vulnérabilité aux chocs extérieurs.
Le potentiel considérable de l’Afrique sur le plan des énergies renouvelables devrait au fil du temps faciliter le passage à des industries plus lourdes, telles que l’acier et le ciment (bien que la viabilité commerciale des technologies propres nécessaires pour décarboner ces secteurs difficiles à verdir demeure incertaine). Des opportunités de développement d’intrants manufacturiers écologiques – tels que les fibres biologiques et les emballages biodégradables – pourraient également être exploitées.
Sans doute le principal obstacle à la mise en œuvre de ces stratégies réside-t-il dans le financement. En raison du risque perçu associé à l’investissement dans les économies en voie de développement, de la fragilité des institutions de gouvernance, ainsi que des défaillances de l’architecture financière mondiale, des montants extrêmement limités de financement climatique parviennent jusqu’en Afrique. Le continent se retrouve ainsi confronté à un manque de financement de 1,6 milliard $ s’il entend atteindre les Objectifs de développement durable de l’ONU d’ici 2030.
Bien qu’il soit nécessaire que les dirigeants africains continuent de plaider pour une réforme du système financier mondial et pour une justice climatique, il leur faut également prendre des mesures immédiates. Les banques multilatérales de développement africaines doivent jouer un rôle beaucoup plus important dans le financement des secteurs à forte productivité et des infrastructures vertes, en monnaies locales et au travers d’investissements à long terme, ce qui nécessitera d’accroître la capitalisation et les capacités techniques de ces institutions cruciales. Les gouvernements doivent mettre un terme aux 88,6 milliards $ de flux financiers illicites qui sortent d’Afrique chaque année.
L’Afrique doit également agir de manière décisive dans le domaine des minéraux. Pour briser la « malédiction des ressources », il est nécessaire que les gouvernements conditionnent l’accès à ces matières premières à des investissements dans la transformation à valeur ajoutée ainsi que dans les capacités industrielles nationales, et exiger plus généralement davantage d’équité dans les partenariats internationaux.
Beaucoup dépendra de la capacité des gouvernements africains à se montrer proactifs sur le marché : formulation d’objectifs stratégiques, promotion de partenariats public-privé dynamiques, et adaptation à l’évolution technologique. Il leur faut investir dans la recherche et développement, promouvoir les compétences en STIM (science, technologie, ingénierie et mathématiques), ainsi que renforcer les liens entre l’industrie et le monde universitaire. Dans cette perspective, il sera essentiel de renforcer les capacités de l’État pour transcrire cette ambition en une transformation économique soutenue.
Enfin, le secrétariat de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECA) et le Conseil des ministres peuvent contribuer à l’élaboration d’un programme d’industrialisation verte pour l’Afrique, ainsi qu’à la coordination des positions de négociation communes au sein des forums mondiaux. Pleinement mise en œuvre, la ZLECA permettrait une augmentation de plus de 81 % des exportations intracontinentales, de 7 % du revenu réel, et serait ainsi idéalement positionnée pour catalyser le développement de nouvelles industries vertes.
L’Afrique doit éviter de renouer avec son rôle historique d’exportateur de ressources naturelles à faible valeur ajoutée. En tirant parti de l’espace politique créé par la situation actuelle, de plateformes régionales telles que la ZLECA, et de stratégies industrielles ambitieuses, le continent peut fixer un nouveau cap vers une prospérité partagée. Il lui faut cependant saisir sans tarder cette opportunité de façonner son avenir sur les plans du climat et du développement.
Par Ellen Davies, Chema Triki et Nimrod Zalk












































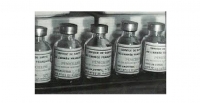






















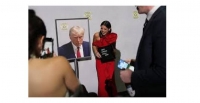


























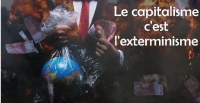
















































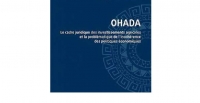

















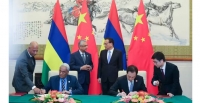















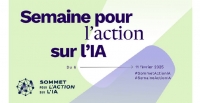













































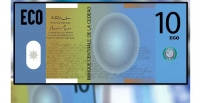
























































































































































































































































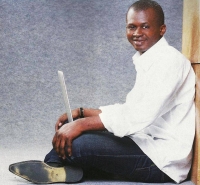



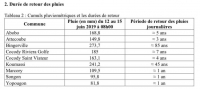




























































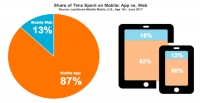


















































































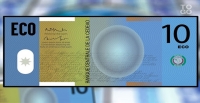


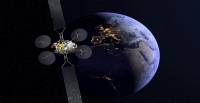






































































































































































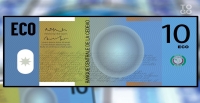






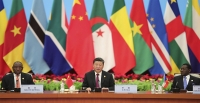

















































































































































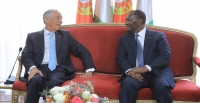







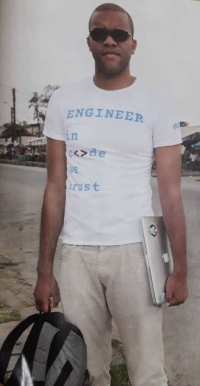








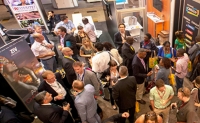






































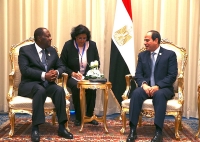









































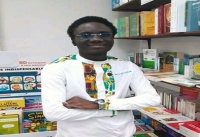














































































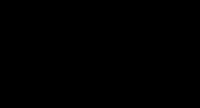

































































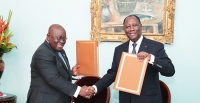








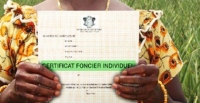




































































































































































































































































































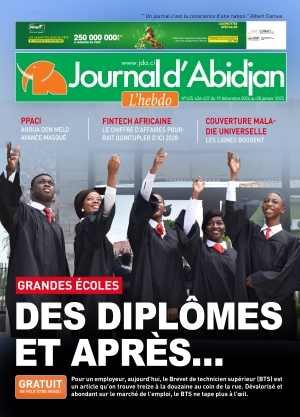

 JDF TV
L'actualité en vidéo
JDF TV
L'actualité en vidéo











