Lorsque nous pensons aux innovations en temps de guerre, nous imaginons généralement des avancées spectaculaires : le décryptage du code Enigma nazi par Alan Turing, l'invention du radar, le développement de la bombe atomique dans le cadre du projet Manhattan. Une innovation biologique moins visible, la production massive de pénicilline, a toutefois été tout aussi révolutionnaire.
Bien qu'Alexander Fleming ait identifié les propriétés antibactériennes de la pénicilline en 1928, celle-ci est restée fragile, instable et presque impossible à produire en quantités significatives pendant plus d'une décennie. Ce n'est que pendant la Seconde Guerre mondiale que la pénicilline a été transformée en un traitement pouvant être produit, distribué et largement utilisé.
Les enjeux étaient considérables. Selon les estimations des archives militaires, pendant la Première Guerre mondiale, environ 12 à 15 % des soldats blessés au combat sont morts d'infections bactériennes. Pour certaines blessures, notamment les fractures du fémur, le taux de mortalité atteignait 80 %, presque entièrement dû à des complications post-traumatiques. La survie dépendait souvent moins de la gravité de la blessure que de la chance.
À la fin de la Seconde Guerre mondiale, lorsque les Alliés ont commencé à produire de la pénicilline à grande échelle, les résultats médicaux ont radicalement changé. Les archives militaires montrent des taux de guérison des infections d'environ 95 %, dépassant de loin l'efficacité des antiseptiques et des sulfamides utilisés auparavant. La mortalité due à des infections comparables est tombée à environ 3-4 %, et on estime que la pénicilline a permis d'éviter des dizaines de milliers d'amputations qui auraient été nécessaires auparavant pour empêcher la propagation de la gangrène. Tout aussi important, elle a considérablement réduit les temps de guérison, raccourcissant la convalescence de plusieurs mois à quelques semaines seulement.
La production massive de pénicilline a été aussi importante pour l'effort de guerre des Alliés que n'importe quelle avancée en cryptographie ou en physique nucléaire. Malgré ses formidables capacités scientifiques, l'Allemagne n'y est pas parvenue. Les efforts de recherche ont commencé tardivement, sont restés confinés à une poignée de laboratoires universitaires et ont stagné au stade expérimental, car les scientifiques nazis n'avaient pas accès à des souches à haut rendement, à des méthodes de fermentation avancées et, surtout, à la coordination institutionnelle nécessaire à une production à grande échelle.
L'expérience des Alliés fut très différente. À partir de 1941, les États-Unis ont mobilisé leurs infrastructures scientifiques et industrielles par l'intermédiaire du Bureau de la recherche scientifique et du développement de Vannevar Bush, finançant des projets de recherche parallèles dans les universités, les laboratoires publics et les entreprises privées, tout en absorbant les risques financiers et scientifiques. En adaptant les techniques de fermentation en cuve profonde, initialement développées pour la transformation alimentaire et la chimie industrielle, 21 entreprises américaines, dont Pfizer, ont pu produire des millions de doses de pénicilline à temps pour le jour J.
Trois caractéristiques du système d'innovation américain se sont avérées décisives. Premièrement, la fabrication de la pénicilline n'a pu être développée à grande échelle que grâce à des investissements soutenus dans des technologies civiles développées bien avant la guerre, telles que la fermentation, la microbiologie et l'ingénierie industrielle. Cette base technologique non militaire est devenue un atout stratégique en temps de guerre. L'Allemagne, malgré sa puissance dans le domaine de la chimie synthétique, ne disposait pas de l'écosystème industriel diversifié nécessaire pour fabriquer des antibiotiques à grande échelle.
Deuxièmement, l'environnement d'innovation américain a été façonné par un gouvernement prêt à prendre des risques. Au début de la guerre, la pénicilline était expérimentale, coûteuse et très incertaine, ce qui n'incitait guère les entreprises privées à investir. L'administration du président Franklin Roosevelt a cependant reconnu que le progrès technologique exigeait une tolérance à l'échec. Par l'intermédiaire du Bureau de la recherche scientifique et du développement, elle a financé un large éventail d'efforts exploratoires, en sachant pertinemment que beaucoup d'entre eux échoueraient. Ce faisant, elle a permis aux approches les plus prometteuses d'émerger et de se développer. En revanche, le système de recherche allemand, plus centralisé, mettait l'accent sur les retombées militaires immédiates et décourageait les expérimentations ouvertes.
Troisièmement, les États-Unis ont mis en place un système d'innovation qui, bien que dispersé, était hautement intégré, reliant les investissements publics, les découvertes universitaires et la mise en œuvre industrielle. Le gouvernement fixait les priorités et absorbait les risques initiaux ; les universités et les laboratoires faisaient progresser la science ; et les entreprises privées transformaient les découvertes en production de masse. Cette division du travail a donné aux Alliés un avantage technologique que l'Allemagne nazie, contrainte par la rigidité institutionnelle, ne pouvait reproduire.
Dans un article récent, mes coauteurs et moi-même soutenons que l'histoire de la pénicilline illustre une tendance plus large dans l'évolution de la technologie américaine. Depuis la Seconde Guerre mondiale, les avancées les plus transformatrices menées par les États-Unis, des semi-conducteurs à la biotechnologie, se sont appuyées sur un cadre institutionnel distinctif : une recherche fondamentale financée par des fonds publics, des universités et des instituts de recherche solides, un secteur privé compétitif capable de développer de nouvelles technologies et des retombées sociales importantes grâce aux investissements publics dans la santé et l'éducation.
La pénicilline, initialement justifiée comme un investissement dans la défense, a finalement eu un impact aussi important sur la guerre que n'importe quelle arme, et elle a transformé la médecine civile et la santé mondiale. En ce sens, l'atout le plus puissant des États-Unis en temps de guerre n'était pas une technologie particulière, mais le système qui a rendu ces avancées possibles.
Les récits de la victoire des Alliés mettent souvent en avant un ensemble restreint de réalisations technologiques. En réalité, les Alliés ont triomphé non seulement parce qu'ils ont construit de meilleures armes, mais aussi parce qu'ils ont créé un écosystème d'innovation plus profond et plus adaptable, suffisamment flexible pour convertir les connaissances scientifiques en outils pratiques et vitaux au moment où cela comptait le plus.
Ce système n'est pas apparu par hasard. Il est le fruit de décisions politiques délibérées qui ont permis d'aligner la recherche universitaire, la capacité industrielle et le développement institutionnel – un lien que l'administration de Donald Trump met en péril en supprimant le financement de la recherche fondamentale et des investissements ciblés, en particulier dans les domaines de la santé (NIH) et des sciences (NSF). Les décideurs politiques d'aujourd'hui doivent se souvenir de la leçon tirée du développement de la pénicilline pendant la guerre : la véritable sécurité dépend autant de la promotion de l'innovation que de l'armement.
Par Paolo Surico


























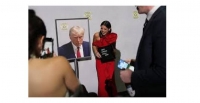






























































































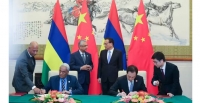








































































































































































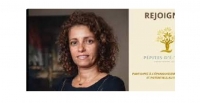




























































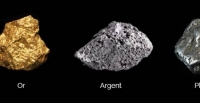

















































































































































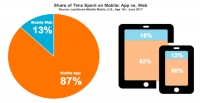





















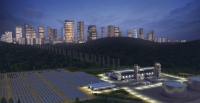































































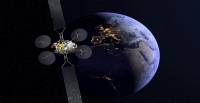













































































































































































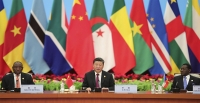

















































































































































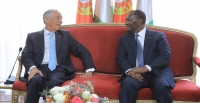







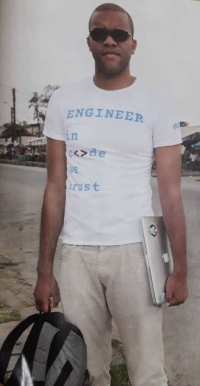








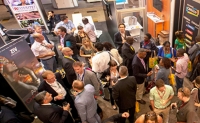






































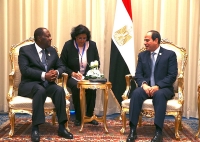
























































































































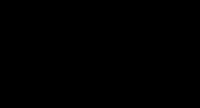

































































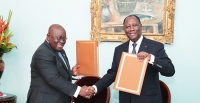














































































































































































































































































































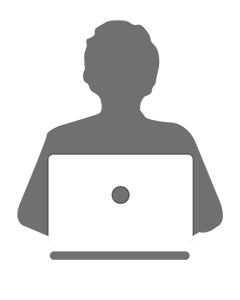
 JDF TV
L'actualité en vidéo
JDF TV
L'actualité en vidéo











